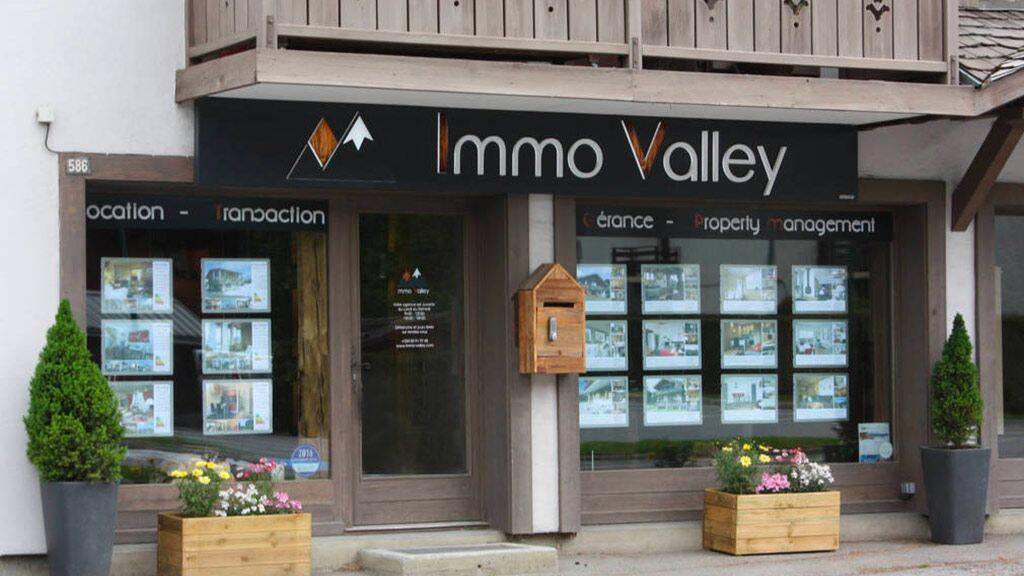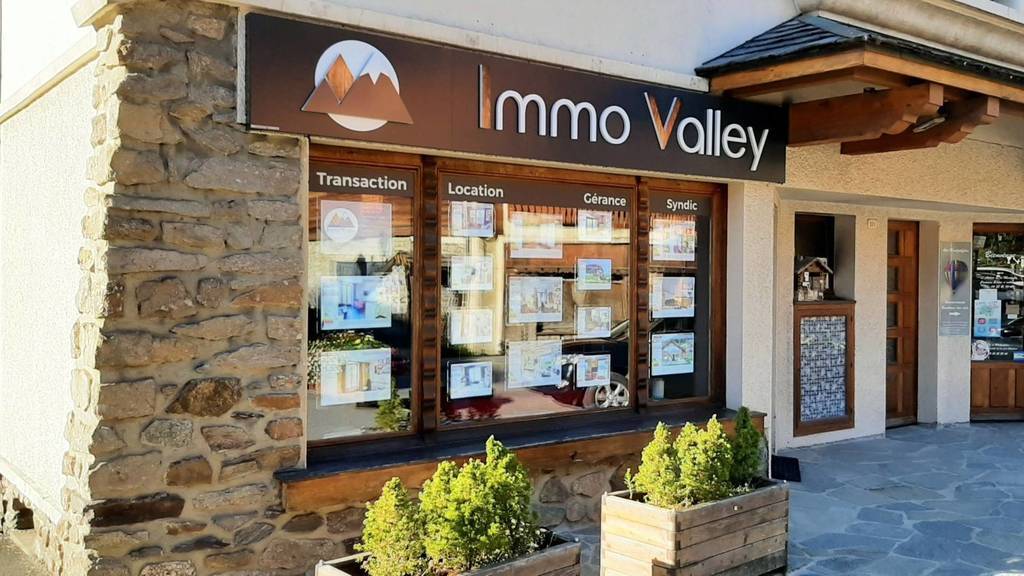Montagne : des paysages sublimes, des risques bien réels
La montagne attire plus que jamais. Avec la canicule et l’envie d’air pur, les vallées se remplissent, les navettes se bondent et les sentiers se couvrent de marcheurs venus de toute la France. Mais derrière cette fréquentation record, un autre chiffre interpelle : +50 % d'interventions de secours en montagne en dix ans. En 2024, 266 personnes y ont perdu la vie, un niveau jamais atteint. Et contrairement aux idées reçues, les « inconscients » ne sont pas la majorité. Les causes ? Mauvaise préparation, mauvaise estimation de ses capacités, ou encore un équipement inadapté face à des conditions souvent plus rudes qu’attendues.
Une randonnée, ça se prépare
À Pralognan, comme dans bien d’autres stations, on sent une prise de conscience émerger. Des stages « Réussir sa rando » sont proposés, où des novices apprennent à lire la météo, à se géolocaliser avec leur smartphone, et surtout à se connaître. « Savoir estimer son niveau, adapter son itinéraire, préparer son sac : ce sont les bases », explique Aurore Ivaldi, encadrante à la Fédération française de randonnée pédestre. En 2024, un quart des personnes secourues avaient mal jugé leurs capacités. Une statistique alarmante, d’autant plus que les secours eux-mêmes signalent que près de 40 % des évacués n’étaient pas blessés, mais simplement bloqués ou perdus.

Quand la météo et le climat redistribuent les cartes
Autre phénomène marquant : la météo n’est plus ce qu’elle était. Les randonnées du printemps ressemblent parfois à des courses d’alpinisme. Neige dure, plaques de glace, névés persistants : un terrain piégeux pour ceux qui partent en baskets. Le réchauffement climatique rend les conditions plus imprévisibles et trompeuses. « Il faut parfois des crampons et un piolet là où on n’en avait jamais eu besoin », avertit Aurore Ivaldi. Résultat : une hausse des accidents liés aux glissades, en particulier en fin de printemps et début d’été.
La génération Z face à la culture du risque
Un phénomène sociologique interroge aussi les secouristes : les « bloqués techniques », souvent jeunes (15-30 ans), représentent près d’un secouru sur cinq. Ces pratiquants, parfois suréquipés, se retrouvent pourtant désemparés face à un imprévu, faute d’avoir été confrontés, plus jeunes, à des situations de gestion autonome du risque. « Cette génération n’a pas grandi dehors, sans surveillance », observe Rémi Pélisson, du Peloton de gendarmerie de haute montagne de l’Isère. Un excès de prudence dans l’enfance se transformerait aujourd’hui en manque d’adaptation sur le terrain.
Former pour prévenir : une réponse concrète
Pour répondre à ces enjeux, la Fédération française de randonnée pédestre a lancé une série de formations estivales dans les parcs nationaux. Objectif : transmettre les « bons réflexes » pour randonner en toute sécurité. Réparties en cinq niveaux, ces formations vont des fondamentaux (lecture de carte, météo, préparation d’itinéraire) au perfectionnement pour les randonneurs aguerris qui manquent de méthode en terrain complexe. « On apprend par l’expérience, en recréant des situations de terrain », précise Aurore Ivaldi. Cette initiative veut faire passer un message clair : randonner, ça s’apprend.
Une passion populaire, un devoir de responsabilité
Aujourd’hui, 56 % des Français pratiquent la marche ou la randonnée. Soit près de 27 millions de personnes. Ce chiffre montre à quel point cette activité est populaire. Mais il impose aussi un devoir de pédagogie. Car si la randonnée est accessible, elle n’est pas anodine. Ce n’est pas parce qu’un sentier est balisé qu’il est sans danger. À l’heure du tourisme de masse en montagne, réapprendre à marcher, à observer, à prévoir, devient plus qu’un besoin : une nécessité.
Source Le Dauphiné Libéré,
Date de mise à jour : 07/01/26
Date de création : 10/07/25